Comment la linguistique computationnelle révèle les
tendances cachées des CDN à l’échelle mondiale.
Alors que les pays
préparent leurs prochaines Contributions Déterminées au Niveau National (CDN)
dans le cadre de l’Accord de Paris, une nouvelle étude menée par ESCP Business
School et l’Universitat Autónoma de Barcelona, publiée dans Nature Sustainability,
révèle que ces engagements climatiques reflètent non seulement des objectifs de
réduction des émissions, mais aussi des priorités économiques, technologiques
et politiques plus larges - avec des variations significatives en matière
d’ambition et de transparence.
En utilisant la
linguistique computationnelle, les chercheurs ont analysé plus de 300 CDN et
identifié 21 groupes thématiques, regroupés en sept grandes catégories. Leurs
conclusions mettent en évidence les arbitrages et les facteurs sous-jacents qui
façonnent les stratégies climatiques nationales - ainsi que les lacunes qui
pourraient compromettre leur mise en œuvre.
Principaux
enseignements : comment les pays définissent leurs engagements climatiques
• Les économies développées (ex. : États-Unis,
Union Européenne, Japon) mettent l’accent sur des objectifs chiffrés de
réduction des émissions, mais fournissent souvent peu de détails sur les
mécanismes politiques et les engagements financiers. Les premières CDN des pays
à hauts revenus étaient souvent succinctes, se limitant principalement à des
objectifs plutôt qu'à des stratégies concrètes.
• Les pays en développement intègrent l’action climatique dans les ODD (Objectifs de développement durable), articulant leurs CDN autour de la croissance économique, de la réduction de la pauvreté et de la résilience climatique. Cela reflète des priorités nationales plus larges et les arbitrages entre réduction des émissions et développement socio-économique.
• Les économies dépendantes des ressources (ex. : Brésil, Russie,
certains pays de l’OPEP) mettent fréquemment en avant les risques économiques
liés aux efforts mondiaux d’atténuation, en particulier les perturbations
potentielles pour les économies dépendantes des énergies fossiles. Cependant, certains
reconnaissent également les opportunités qu’offre une transition vers des
économies plus diversifiées et circulaires.
• Les pays vulnérables au climat (ex. : Petits États
insulaires en développement, certaines régions d’Afrique subsaharienne)
consacrent une part importante de leurs CDN à l’adaptation au changement
climatique, soulignant leur contribution historique négligeable aux émissions
mondiales et appelant à un soutien international renforcé.
Comment les engagements
climatiques ont évolué
Les CDN varient
considérablement en longueur - de 96 mots (première CDN du Kazakhstan) à 76 275
mots (CDN mise à jour du Venezuela) - mais leur focus thématique a évolué. Les
premières soumissions des pays les plus riches étaient souvent brèves et axées sur
les objectifs, tandis que les pays en développement adoptaient une approche
plus large, intégrant des enjeux de développement. Au fil du temps, les mises à
jour se sont orientées vers des objectifs d’atténuation plus détaillés et une
comptabilisation structurée des émissions de gaz à effet de serre.
Toutefois, une lacune
majeure persiste : de nombreux engagements manquent encore de transparence, en
particulier sur les financements et la mise en œuvre. Comme l’explique
Ivan Savin, Professeur associé à ESCP Business School et auteur principal de
l’étude : « Cette étude met en lumière une fracture dans les engagements
climatiques : les pays les plus riches se concentrent sur des objectifs
chiffrés mais sans détails concrets sur les politiques, tandis que les pays en
développement intègrent l’action climatique dans leurs priorités économiques et
sociales. Pourtant, des lacunes persistent, notamment en matière de
transparence sur le financement et les politiques spécifiques. Sans des
engagements plus clairs et redevables, les objectifs de l’Accord de Paris risquent
de rester lettre morte ».
Pourquoi ces conclusions sont essentielles et ce qui doit changer
Cette recherche révèle
un écart important dans la mise en œuvre des politiques climatiques à l’échelle
mondiale. Bien que de nombreuses CDN soient devenues plus détaillées, elles
restent très hétérogènes, rendant difficile la comparaison des engagements et
la responsabilisation des États.
Pour garantir de réels
progrès, l’étude souligne la nécessité des :
• Formats de reporting
standardisés pour une transparence et une comparabilité accrue.
• Mécanismes de
responsabilisation renforcés pour suivre les progrès au-delà des seuls
objectifs de réduction des émissions.
•Engagements financiers
plus clairs pour traduire les promesses en actions concrètes, en particulier
dans les pays en développement.
Sans ces améliorations,
l’Accord de Paris risque de rester une simple déclaration d’intentions plutôt
qu’un cadre réel de réduction des émissions. Cette étude apporte une
perspective fondée sur les données quant à la manière dont les pays
communiquent leurs priorités climatiques - et ce qui doit évoluer pour rendre
ces engagements plus efficaces.
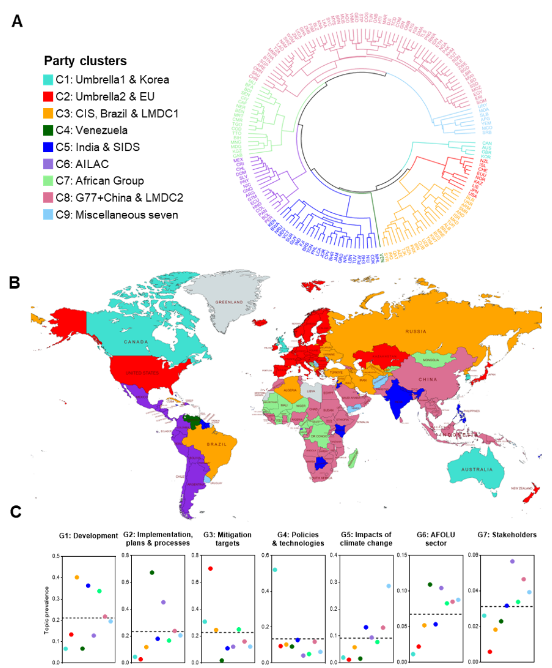
Figure 1. Regroupement
des parties à l’Accord de Paris et prévalence des thématiques.
(A) Dendrogramme radial
classant les parties selon la prévalence des thématiques dans leurs CDN.
(B) Carte représentant
neuf clusters de parties à l’Accord de Paris.
(C) Prévalence moyenne de chacun des groupes thématiques parmi les clusters identifiés. À noter : les échelles des axes y des sept graphiques sont différentes. Les lignes en pointillés indiquent la moyenne pour chaque groupe thématique à travers les neuf clusters. Les couleurs sont cohérentes entre les trois sous-figures.


